Platform Engineering : les architectures modernes

Sommaire
- Platform Engineering : définition et rôle
- L’approche produit
- Le self-service : autonomiser les équipes
- Le portail self-service : une interface utilisateur essentielle
- Intégration avec DevOps
- Conclusion

Platform Engineering : définition et rôle
L’ingénierie de plateforme est un concept relativement nouveau mais profondément ancré dans l’évolution des pratiques DevOps. Pour comprendre son émergence (2009), il est crucial de retracer son évolution et son historique.
Alors que DevOps gagnait en popularité (2021), de nouvelles pratiques et outils ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques des équipes de développement et d’opérations. L’ingénierie de plateforme est apparue comme une évolution naturelle de ces pratiques, visant à fournir une infrastructure plus efficace, flexible et automatisée.
Le Platform Engineering consiste à concevoir, développer et gérer des plateformes technologiques personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’une organisation. Ces plateformes sont conçues pour faciliter la création, le déploiement et l’exploitation d’applications, de services et de systèmes logiciels, en fournissant une fondation stable, évolutive et efficace.
L’objectif est de créer une infrastructure qui reflète les exigences spécifiques de l’organisation (besoins en termes de sécurité, performances, évolutivité, etc.). Cette approche permet à l’organisation de s’adapter rapidement aux changements de l’environnement technologique et de ne pas s’enfermer, à terme, dans une forme de dette technologique.
La plateforme vise à automatiser autant de tâches que possible, des déploiements de code à la gestion des ressources, afin de réduire le risque d’erreurs humaines et d’augmenter l’efficacité (logique « Everything as Code »).
En offrant un ensemble de normes et de pratiques, l’ingénierie de plateforme assure une cohérence dans le développement et le déploiement, facilitant ainsi la maintenance et l’évolution des systèmes.
En construisant des outils et des interfaces adaptés, la plateforme facilite la collaboration entre les équipes de développement, d’exploitation, de sécurité ou d’autres services clés.
Enfin, les solutions d’ingénierie de plateforme sont conçues pour s’adapter et évoluer en fonction de la croissance de l’entreprise, que ce soit en termes de volume de données, de nombre d’utilisateurs ou de complexité des applications.
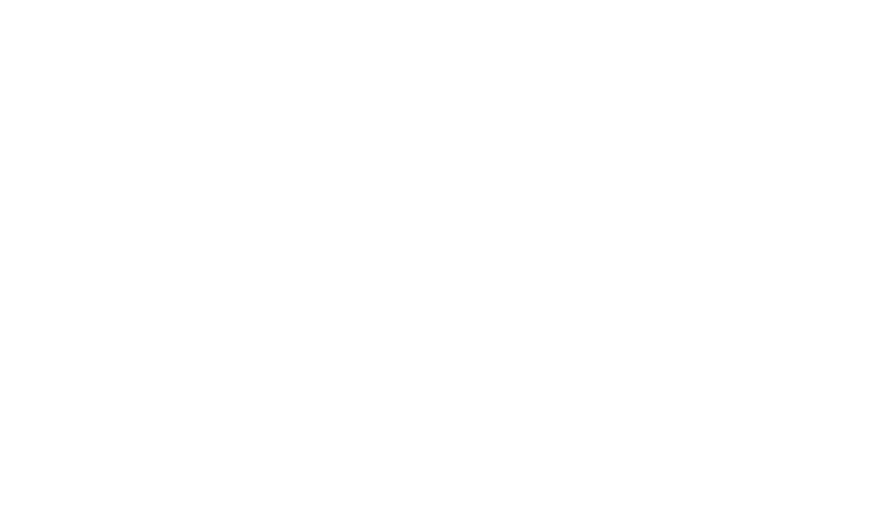
En 2023, Microsoft a souligné que l’adoption de l’ingénierie de plateforme avec des capacités en self-service avait réduit de 40% le temps de provisionnement des ressources. Cela a permis aux développeurs de déployer des applications plus rapidement et de manière autonome, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et favorisant l’innovation.
En simplifiant et en accélérant le processus de développement et de déploiement, l’ingénierie de plateforme permet aux organisations de répondre plus rapidement aux besoins changeants du marché ou de l’entreprise.
En somme, l’ingénierie de plateforme est au cœur de la transformation numérique moderne, offrant aux entreprises les outils et la flexibilité nécessaires pour naviguer dans un paysage technologique en constante évolution. Bien conçue, une plateforme peut devenir un avantage concurrentiel majeur, permettant une innovation rapide tout en maintenant une base solide et sécurisée.
Couche d’abstraction pour les utilisateurs
L’ingénierie de plateforme crée une couche d’abstraction qui simplifie l’accès aux ressources et outils pour l’ensemble des utilisateurs, qu’ils soient développeurs, opérateurs ou administrateurs. Cette couche d’abstraction permet de masquer la complexité sous-jacente de l’infrastructure et des outils, offrant une interface utilisateur unifiée et intuitive. Les équipes peuvent ainsi provisionner, déployer et gérer les applications de manière plus autonome et efficiente. En éliminant les obstacles techniques, cette approche facilite la collaboration interdisciplinaire et accélère l’innovation à tous les niveaux de l’organisation.
Aide apportée aux développeurs
Enfin, l’ingénierie de plateforme joue un rôle crucial dans l’aide apportée aux développeurs. En fournissant des environnements de développement standardisés et des outils d’automatisation, elle réduit la charge de travail des développeurs*. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur la création de nouvelles fonctionnalités et sur l’amélioration de la qualité du code, plutôt que sur la gestion de l’infrastructure. Cette approche accélère le cycle de développement et améliore la satisfaction et la productivité des équipes de développement : on parle de Développer Expérience (DevX).
L’approche produit
L’un des principes fondamentaux de l’ingénierie de plateforme consiste à adopter une mentalité axée sur le produit. Au lieu de simplement développer un logiciel pour répondre à des spécifications ou résoudre des problèmes urgents en production, les ingénieurs appliquent les meilleures pratiques de gestion en considérant leur plateforme comme un produit en tant que tel. Les développeurs sont des clients à part entière, et leurs besoins sont prioritaires lors de la création de la plateforme. Par la suite, et afin d’optimiser les systèmes, nous invitons les ingénieurs de plateforme à interroger régulièrement les développeurs sur leurs besoins et à écouter attentivement leurs réponses. Cette approche, directe et factuelle, évite les frictions entre les équipes et résout bien des problèmes.
Par ailleurs, considérer la plateforme comme un produit ne signifie pas acheter une solution couvrant l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Contrairement à l’utilisation d’une PaaS (Platform as a Service) ou d’une solution DevOps complète, concevoir une telle plateforme offre un contrôle total sur vos solutions, intégrant à la fois d’anciens outils que des nouveaux selon les besoins. Cela permet également de définir des flux de travail adaptés à votre organisation et à vos développeurs, qu’ils soient basés sur une interface utilisateur ou sur Git.
IDP (Internal Developer Plateform)
La construction d’une IDP (Internal Developer Plateform) consiste à regrouper diverses technologies et outils afin de créer un chemin optimal allégeant la charge des contributeurs individuels. Cette approche favorise l’autonomie et l’auto-service pour les ingénieurs, tout en soutenant des pratiques de travail efficaces grâce à des processus structurés.
De nombreuses organisations créent des IDPs pour éviter de réinventer constamment la roue. Les plateformes couvrent les besoins opérationnels du cycle de vie d’une application, permettant aux développeurs de se concentrer sur la création de services en s’appuyant sur des cadres communs. Il est crucial pour les ingénieurs de plateforme de repartir de l’existant afin d’apporter un maximum de valeur en un minimum de temps.
Pour cela, nous invitons les équipes à se poser plusieurs questions structurantes, par exemple : comment fusionner les solutions commerciales de Humanitec avec des outils open source comme Argo et Backstage, pour une approche cohérente pour mon équipe ?
Une fois cette synergie trouvée, le rôle de l’équipe de plateforme est vraiment axé sur l’optimisation continue.
En résumé, l’ingénierie de plateforme se concentre sur la création et la gestion d’environnements de développement et de production standardisés et automatisés. Cela inclut l’utilisation de l’Infrastructure as Code (IaC), des pipelines CI/CD, et des outils de gestion de configuration pour assurer que les ressources sont provisionnées et gérées de manière cohérente et reproductible.
L’ingénierie de plateforme est une évolution clé des pratiques DevOps. Elle vise à fournir des environnements de développement et de production standardisés, automatisés et efficaces. Cette approche transforme la manière dont les entreprises gèrent leurs ressources technologiques, favorisant l’agilité, l’innovation et la collaboration inter-équipes.
Le self-service : autonomiser les équipes
Le concept de self-service est un élément clé de l’ingénierie de plateforme. Il permet aux utilisateurs de provisionner et de gérer eux-mêmes les ressources nécessaires à leurs projets. Cette approche réduit la dépendance vis-à-vis des équipes IT traditionnelles, accélère les cycles de développement et de déploiement, et améliore l’efficacité opérationnelle.
Le self-service est d’une importance capitale :
- Il accélère les cycles de développement en permettant aux développeurs d’accéder rapidement aux ressources sans attendre l’approbation des équipes IT. Il réduit les goulots d’étranglement et favorise des livraisons de fonctionnalités et des mises à jour plus fréquentes. L’entreprise est alors plus réactive aux besoins du marché.
- Le self-service autonomise les équipes. Il offre la liberté de provisionner et de gérer les environnements selon leurs besoins spécifiques, sans dépendre d’autres équipes. Cette autonomie stimule l’innovation et améliore la gestion du temps et des ressources.
- Grâce à l’automatisation, le self-service permet de maintenir un haut niveau de standardisation et de contrôle. Les processus et configurations définis par les équipes de plateforme garantissent que toutes les actions respectent les meilleures pratiques et les politiques de l’entreprise, assurant ainsi la cohérence et la sécurité des environnements.
- Cette approche réduit également les coûts opérationnels en minimisant la nécessité d’interventions manuelles*. Les ressources sont utilisées de manière plus efficace, augmentant ainsi la productivité des équipes. En facilitant la collaboration entre les équipes de développement, d’opérations et de sécurité, le self-service crée un environnement de travail plus coordonné et transparent.
- Enfin, il offre une flexibilité maximale, permettant aux entreprises de s’adapter rapidement aux besoins changeants du marché en ajustant les ressources provisionnées en fonction de la demande.
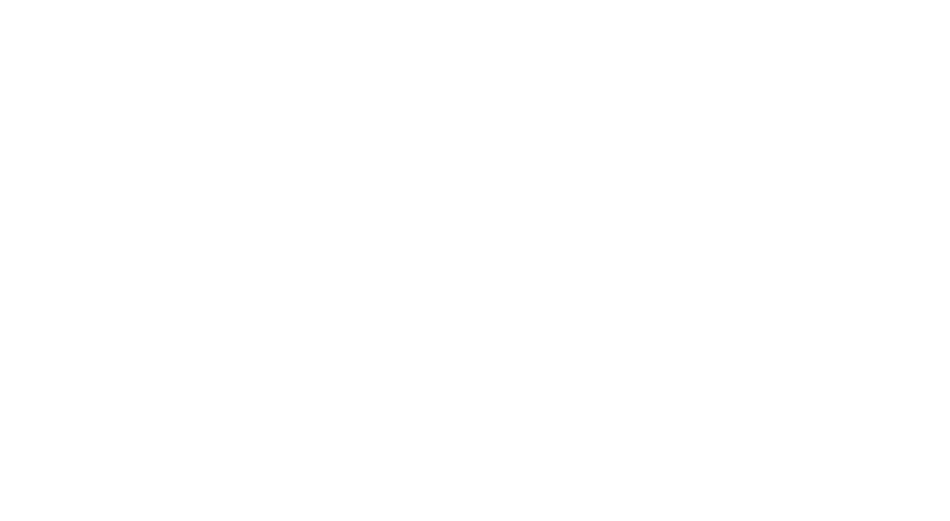
En 2023, une étude de Forrester a révélé que les entreprises ayant mis en place des capacités de self-service pour leurs équipes techniques ont vu une augmentation de 30% de la satisfaction des développeurs. De plus, ces entreprises ont rapporté une diminution de 25% des coûts opérationnels liés à la gestion de l’infrastructure.
En somme, le self-service transforme la gestion des ressources technologiques. Il rend les opérations plus agiles et réactives, tout en favorisant l’innovation et l’efficacité. Cette approche est essentielle pour toute organisation cherchant à rester compétitive et à répondre aux attentes de ses clients.
Le portail self-service : une interface utilisateur essentielle
Le portail self-service dans le monde du DevOps représente une avancée importante pour les équipes IT et les développeurs. Imaginez un tableau de bord centralisé, accessible via un simple navigateur, qui transforme la gestion des ressources et des opérations en une expérience fluide et autonome. Ce portail se divise en quatre piliers fondamentaux, chacun jouant un rôle crucial dans l’efficacité et la flexibilité des processus DevOps. Nous déclinons ces rôles (non-exhaustifs) ci-après :
- La section « Provisioning & Administration » est le cœur du portail. Elle permet aux utilisateurs de déployer et de configurer rapidement des environnements de développement et de production. Grâce à des outils automatisés et des interfaces intuitives, la gestion des ressources devient un jeu d’enfant. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur la création de valeur ajoutée plutôt que sur les tâches administratives répétitives.
- Le portail self-service est également conçu pour intégrer et gérer des environnements hybrides. Que les ressources soient sur site, dans le cloud ou dans une configuration mixte, cette section assure une gestion cohérente et harmonieuse. Les équipes peuvent orchestrer et superviser l’ensemble de leurs ressources à partir d’un seul point de contrôle, assurant une agilité et une adaptabilité maximales.
- La surveillance proactive est essentielle pour maintenir la performance et la fiabilité des applications et des services. La section relative au monitoring offre des outils avancés qui fournissent des insights détaillés sur l’état des systèmes. Les alertes en temps réel et les rapports permettent une détection anticipée des anomalies et une résolution rapide des problèmes, minimisant ainsi les interruptions de service. Plus récemment, certaines solutions analysent également la consommation de CO2 induite par les workloads.
- Enfin, la gestion financière des opérations (FinOps) est simplifiée et optimisée. Le module FinOps offre une visibilité complète sur les coûts associés à l’infrastructure et aux services utilisés. Les équipes peuvent surveiller les dépenses en temps réel, prévoir les budgets et identifier les opportunités d’optimisation. Elles garantissent ainsi une utilisation efficace des ressources financières.
En résumé, le portail self-service DevOps est une passerelle vers une gestion plus efficace, plus transparente et plus autonome des opérations IT. C’est une véritable couche d’abstraction de la complexité technologique. Il libère les équipes des tâches chronophages et leur permet de se concentrer sur l’innovation et la livraison rapide de valeur. Cet outil est parfaitement adapté aux sociétés évoluant en milieu hybride et souhaitant donner de l’autonomie aux équipes.
Intégration avec DevOps
L’ingénierie de plateforme se positionne comme une intégration « idéale » des méthodes DevOps et non une substitution.
La vision DevOps consiste à exploiter les méthodologies, outils et cadres collaboratifs pour optimiser la qualité logicielle et le cycle de développement. Elle mobilise ainsi diverses techniques et ressources pour fluidifier le développement, la surveillance (observabilité) et la gestion (MCO).
L’ingénierie de plateforme intervient pour fusionner ces méthodes, ressources et stratégies en vue de concevoir des services et des outils autonomes et réutilisables pour diverses équipes au sein de l’entité, le tout, dans une logique de marketplace.
Dans l’idéal, cette ingénierie propulse la productivité des développeurs en garantissant uniformité et performance. Elle propose un environnement favorable au développement de produits et une plateforme adaptée. Celle-ci met à disposition des outils autonomes réutilisables avec des processus d’infrastructure automatisés.
Les développeurs peuvent ainsi exploiter ces composants modulables et ces services. Cette plateforme présente notamment l’avantage de fournir des composants de production uniformisés (GitOps) et des outils et des processus automatisés (Everything as Code).
Prenons un exemple : une équipe souhaite instaurer un service de gestion des données sensibles. Au sein de l’organisation, différentes approches peuvent émerger. Afin d’éviter que chaque équipe crée sa propre solution, l’ingénierie de plateforme peut centraliser ce service.
Ceci conduit à des avantages tels qu’une standardisation, une réutilisabilité accrue et une économie de temps. Cette méthode conduit inévitablement à une capacité de reproduction, pierre angulaire du modèle d’évolution DevOps.
Conclusion
En conclusion, cette organisation centrée sur le produit et intégrant des pratiques DevOps favorise non seulement l’innovation et l’efficacité opérationnelle, mais améliore également significativement l’expérience des développeurs. En créant un environnement où les équipes peuvent collaborer de manière transparente et en s’appuyant sur des outils et des processus optimisés, les entreprises peuvent atteindre des niveaux de performance élevés tout en maintenant une forte satisfaction et engagement des équipes. Cela se traduit généralement par une meilleure qualité de produit, une réponse rapide aux besoins du marché, et un avantage compétitif durable.
