Architectures éco-responsables
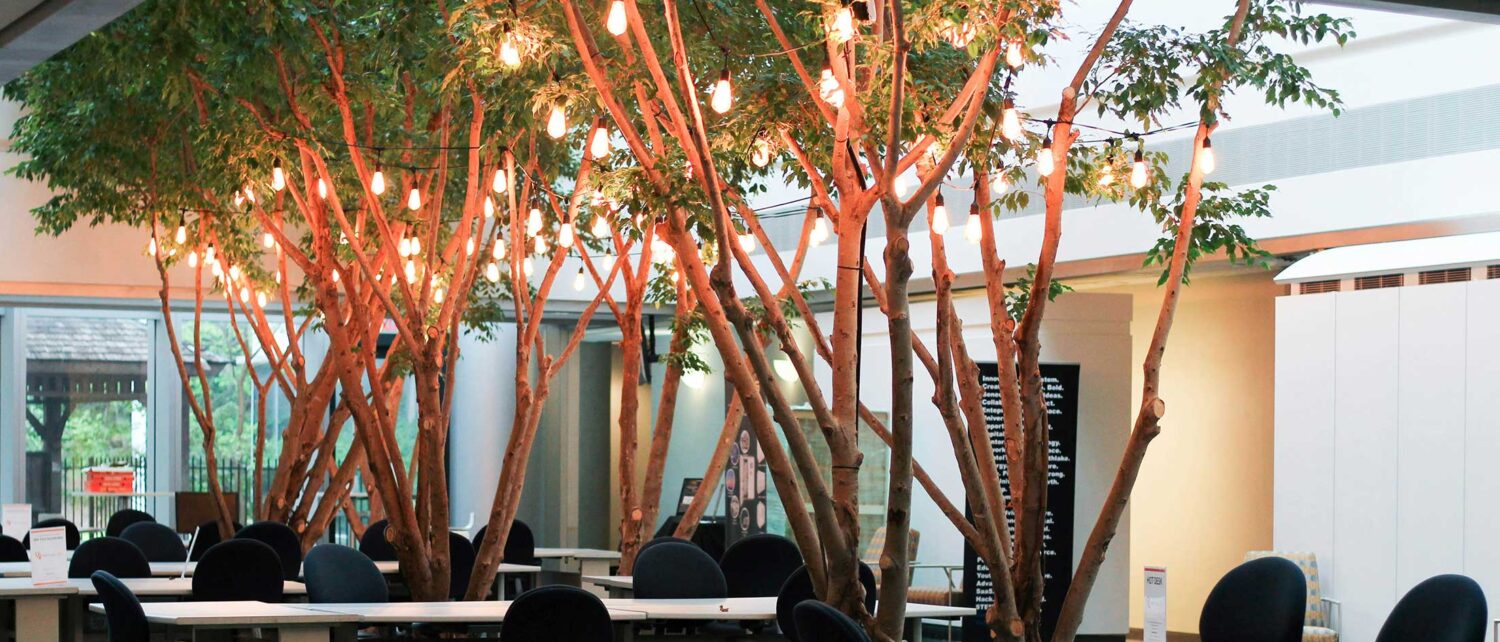
Sommaire
- Introduction
- Le théorème de BREWER
- Des architectures au service de la durabilité
- Le Edge Computing
- L’architecture Local-First
- Le pattern CQRS (Command Query Responsability Segregation)
- Conclusion

Introduction
Après avoir sélectionné un framework adapté à vos besoins et à vos contraintes, il est essentiel de structurer vos architectures éco-responsables, en cohérence avec ces choix. Une architecture bien pensée permet d’optimiser les performances, de limiter la consommation énergétique et d’assurer la pérennité du système tout en répondant aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Toutefois, ces décisions impliquent souvent des compromis entre performance, résilience et complexité.
Le théorème de BREWER
Pour vous guider dans ces choix, vous pouvez vous appuyer sur le principe fondamental de Brewer, ou théorème « CAP », selon lequel chaque système distribué ne peut garantir simultanément que deux des trois propriétés suivantes : cohérence, disponibilité et tolérance aux partitions. Ce cadre d’analyse permet d’orienter les décisions architecturales en fonction des priorités du projet, tout en intégrant une démarche plus sobre et efficiente.
| Cohérence (Consistency) | Disponibilité (Availability) | Tolérance aux partitions (Partition Tolerance) |
|---|---|---|
| Application : Cette propriété assure que toutes les copies de données distribuées sur différents nœuds sont toujours synchronisées. Chaque lecture renvoie la dernière écriture effectuée, garantissant une vision uniforme des données à tout utilisateur, peu importe le nœud auquel il accède. | Application : Chaque requête reçoit une réponse, même en cas de panne d’une partie du système. Ceci est souvent réalisé par la réplication des données sur plusieurs nœuds pour garantir qu’elles soient toujours accessibles, même si certains nœuds ou liaisons sont défaillants. | Application : Le système continue de fonctionner même en présence de pannes réseau en isolant certains nœuds du reste du système. |
| Implication : Pour maintenir une cohérence stricte, des mécanismes de verrouillage ou de transactions coordonnées doivent être implémentés, ce qui peut ralentir les performances et réduire la disponibilité en cas de défaillance d’un nœud ou de séparation réseau. | Implication : Favoriser la disponibilité peut conduire à des situations où les données lues ne sont pas les plus récentes (cohérence éventuelle) car le système privilégie une réponse rapide à la cohérence stricte entre les nœuds. | Implication : Si la tolérance aux partitions est priorisée, il peut être nécessaire de sacrifier la cohérence ou la disponibilité. Par exemple, pour maintenir la cohérence dans un environnement partitionné, certaines opérations pourraient devoir être refusées pour éviter les incohérences. |
Architectures éco-responsables : que choisir ?
Selon les priorités définies par le théorème de Brewer, différents choix architecturaux peuvent être envisagés. Dans cette partie, intéressons-nous aux architectures moins connues et/ou les plus prometteuses en termes de perspectives.
Le Edge Computing
Le concept de Edge Computing consiste à traiter les données au plus près de la source, à la périphérie du réseau, plutôt que dans un centre de données centralisé. Cette approche réduit la latence et minimise la bande passante nécessaire. Explorons comment l’Edge Computing s’aligne avec les principes d’éco-conception et discutons d’un exemple concret avec les réseaux de distribution de contenu (CDN).
Les avantages de l’Edge Computing :
- Diminution de la bande passante : Les données transférées sur de longues distances sont moindres, ce qui réduit la charge sur le réseau et diminue la consommation d’énergie liée au transfert de données.
- Optimisation de la consommation d’énergie : En décentralisant le traitement des données et en le rapprochant des utilisateurs, l’Edge Computing peut réduire la consommation énergétique des centres de données et exploiter plus efficacement les ressources locales.
Les inconvénients de l’Edge Computing :
- Gestion des ressources : La mise en place de l’infrastructure nécessaire à l’Edge Computing peut nécessiter des investissements importants en termes de matériel et de gestion.
- Sécurité des données : La dispersion des points de traitement augmente la surface d’attaque potentielle, nécessitant des mesures de sécurité renforcées pour protéger les données traitées à la périphérie.
- Complexité de la maintenance : La gestion et la maintenance de multiples points de traitement distribués peuvent introduire des défis logistiques et augmenter les coûts opérationnels.
Un Content Delivery Network (CDN) est un exemple parfait d’application de l’Edge Computing, où le contenu est stocké et servi depuis des emplacements géographiquement proches des utilisateurs. Par exemple, un site web peut utiliser un CDN pour stocker des copies de ses pages, vidéos, et autres contenus sur plusieurs serveurs dispersés à travers le monde. Lorsqu’un utilisateur accède à ce contenu, il est servi par le serveur le plus proche, ce qui réduit la latence, diminue la charge sur les serveurs centraux et économise la bande passante.
L’intégration de l’Edge Computing dans la stratégie globale d’une entreprise peut non seulement améliorer la performance et la réactivité des applications mais aussi contribuer à une conception plus durable des systèmes informatiques. Néanmoins, il faut prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la production du matériel nécessaire à cette approche, il est donc primordial de quantifier l’énergie consommée et les émissions de GES afin de pouvoir établir une analyse complète du plan d’amortissement écologique sur la durée de vie des applications. Si cet équilibre écologique n’est pas atteignable, il serait judicieux de reconsidérer cette stratégie jusqu’à ce qu’une solution plus équilibrée soit disponible.
L’architecture Local-First
Aborder l’architecture Local-First sous l’angle de l’éco-conception présente une perspective intéressante :
Les avantages de l’architecture Local-First :
- Optimisation des ressources : En privilégiant le stockage et le traitement des données sur l’appareil de l’utilisateur, les applications Local-First sont conçues pour être plus économes en ressources.
- Disponibilité hors ligne : Les applications restent fonctionnelles même sans connexion Internet, ce qui réduit le besoin permanent de connexion et l’utilisation de la bande passante.
- Contrôle des données par l’utilisateur : En stockant les données localement, les utilisateurs ont un contrôle accru sur leurs informations.
- Minimisation de la bande passante et diminution de la dépendance au Cloud : En utilisant le cache comme levier de performance, la bande passante est moins sollicitée et la dépendance au Cloud réduite.
Les inconvénients de l’architecture Local-First :
- Gestion de l’espace de stockage : Les développeurs doivent gérer soigneusement l’utilisation de l’espace de stockage local pour éviter de saturer les appareils.
- Sécurité des données locales : Stocker des données sensibles localement impose des mesures de sécurité robustes pour protéger ces données.
Cette architecture peut être adaptée à un contexte d’application mobile par exemple.
En effet, les applications mobiles Local-First utilisent des bases de données locales telles que SQLite (ou des enveloppes comme Room sur Android) et CoreData sur iOS pour stocker les données directement sur l’appareil. Cela permet un accès rapide aux données sans nécessiter une connexion réseau constante. Les mécanismes de synchronisation des données entre l’appareil local et le serveur (ou autres appareils) sont alors essentiels. Des frameworks comme Firebase, Couchbase Lite, ou des solutions personnalisées basées sur des algorithmes de résolution de conflits (par exemple : CRDTs ou OT) sont souvent utilisés pour gérer les modifications concurrentes et assurer la cohérence des données. Enfin, le traitement local des données, y compris le filtrage, le tri, et les calculs, réduit la dépendance aux serveurs distants.
L’architecture Local-First présente des opportunités d’éco-conception certaines, en particulier dans le contexte des applications mobiles. Du fait de la réduction de la dépendance aux serveurs distants et en optimisant l’utilisation des ressources de l’appareil, elle contribue à une moindre consommation d’énergie globale.
En résumé, adopter une architecture Local-First pour les applications mobiles ou pour toute autre application dans une perspective d’éco-conception, exige un équilibre entre les avantages techniques, l’amélioration de l’expérience utilisateur, la gestion des défis liés à la synchronisation & à la sécurité des données, et la responsabilité environnementale. Cela implique une réflexion approfondie sur les choix de conception et d’architecture pour maximiser l’efficacité et la durabilité des applications mobiles.
Le pattern CQRS (Command Query Responsability Segregation)
Pour approfondir l’analyse des approches architecturales favorisant l’éco-conception, il est pertinent d’examiner également d’autres modèles, comme le Command Query Responsibility Segregation (CQRS).
Ce modèle sépare les opérations de lecture (Query) des opérations d’écriture (Command), permettant des optimisations. Cette séparation aide à améliorer la performance et l’efficacité des systèmes.
Les avantages du CQRS :
- Optimisation de la consommation d’énergie : En séparant les charges de travail de lecture et d’écriture, CQRS permet une gestion plus ciblée des ressources. Les serveurs peuvent être optimisés pour leur fonction spécifique.
- Réduction de la charge serveur : Les composants de lecture, souvent sollicités plus fréquemment, peuvent être mis à l’échelle indépendamment des composants d’écriture, permettant une meilleure allocation des ressources serveur (scalabilité sélective).
- Amélioration de la durabilité des applications : La clarté structurelle apportée par le CQRS simplifie la maintenance et les mises à jour des systèmes, prolongeant ainsi leur durée de vie opérationnelle et réduisant le besoin de ressources pour des remplacements fréquents.
Les inconvénients du CQRS :
- Au-delà du risque de manque de consistance des données, nous pouvons également citer la complexité de gestion des évènements. En effet, le CQRS étant utilisé en conjonction avec le pattern Event Sourcing – où les changements d’état sont stockés comme une séquence d’événements – cela nécessite une infrastructure robuste pour gérer, stocker, et reconstituer l’état à partir de ces événements. Cette complexité peut augmenter le risque de manque de consistance des données.
Par exemple, une plateforme de vente en ligne nécessite de lire des listes complètes de produits des milliers de fois par jour, tandis que les opérations d’écriture, (telles que la création et la mise à jour des produits), sont relativement rares. L’architecture CQRS peut grandement améliorer l’efficacité de ce type de système en isolant les opérations de lecture et d’écriture.
Comprenez bien que la synchronisation des données constitue le nerf de la guerre de cette architecture, il est donc essentiel d’y prêter une attention toute particulière.
Le CQRS est intrinsèquement une architecture axée sur les performances. Une perspective prometteuse consiste à renforcer les optimisations inhérentes de cette architecture en faveur de l’éco-conception, notamment par la création de frameworks optimisés et prêts à l’emploi.
Conclusion
La conception de logiciels durables est essentielle dans un monde où l’impact environnemental est de plus en plus pris en compte. Les architectures comme l’Edge Computing, l’Architecture Local-First, et le pattern CQRS offrent des solutions prometteuses pour allier performance et durabilité. Chacune de ces approches a ses avantages : le Edge Computing réduit la latence et la consommation d’énergie en décentralisant le traitement des données, l’Architecture Local-First limite la dépendance au Cloud en traitant les données localement, et le CQRS optimise l’utilisation des ressources en séparant les opérations de lecture et d’écriture.
Cependant, ces architectures ne sont pas sans défis. L’Edge Computing nécessite des investissements importants en infrastructure et en sécurité, l’Architecture Local-First pose des problèmes de synchronisation et de gestion des ressources, et le CQRS exige une gestion complexe des événements et des conflits.
Pour intégrer ces architectures éco-responsables dans une stratégie globale, il est crucial d’évaluer leur impact environnemental et de mener une analyse approfondie des compromis entre performance, complexité et durabilité. En fin de compte, l’objectif est de concevoir des systèmes qui, non seulement fonctionnent efficacement, mais qui contribuent également à la préservation de l’environnement.
Pour découvrir la suite de notre série d’articles autour de l’éco-conception, c’est par ici.
